Marrakech n’est pas un simple décor dans L’Homme qui en savait trop (1956) d’Alfred Hitchcock : la ville façonne l’intrigue, révèle les personnages et réoriente l’imaginaire d’un thriller qui commence dans la chaleur du Maghreb pour culminer à Londres. Dès l’ouverture, le film prévient que tout se jouera ailleurs : « A single crash of Cymbals and how it rocked the lives of an American family », annonce la séquence qui renvoie au Royal Albert Hall. Mais c’est à Marrakech que le danger s’amorce, quand le docteur Ben McKenna (James Stewart), en vacances avec Jo (Doris Day) et leur fils, voit mourir dans ses bras un certain Louis Bernard, inconnu aperçu quelques jours plus tôt au souk. Avant de s’éteindre, Bernard lui souffle : « A man, a statesman, is to be killed – assassinated – in London. Soon very soon. Tell them in London to try Ambrose Chappell. » Une note griffonnée, un faux indice, et l’histoire devient un récit de deux villes traversé par un leurre.
Ce déplacement par rapport au film de 1934 — où Bob et Jill Lawrence voient leur fille kidnappée en Suisse — n’est pas anodin. En rejouant son propre matériau à vingt ans d’intervalle, Hitchcock troque l’Europe feutrée pour une géographie élargie et un imaginaire plus massif. Le remake en couleurs, tourné en partie en Afrique du Nord, annonce les futurs récits d’espionnage à la James Bond — action, cascades, voyages —, jusqu’à inspirer des échos directs : la tentative d’assassinat à l’opéra revisitée par Mission : Impossible – Rogue Nation transpose le dispositif hitchcockien en le reconduisant au Maroc. Hitchcock lui-même disait préférer la version de 1956, qu’il considérait comme « le travail d’un professionnel » plutôt que, pour la première, celui d’un « amateur talentueux ».
Dans ce cadre, Marrakech condense des désirs d’après-guerre — voyager, s’éblouir, oublier la pénurie — et la persistance du traumatisme. Ben a servi en Afrique du Nord ; ce qui fut théâtre d’horreurs devient lieu de nostalgie… jusqu’au retour brusque de la mort. Le film « code » la ville comme une zone d’ambivalence et de possible menace dans le regard occidental des années 1950 : « dark continent », lancent les McKenna, et le récit instille la peur de ce qui est perçu comme obscur, étranger, insaisissable. Le choc des usages est parfois joué pour rire — l’embarras d’un poulet mangé avec les doigts — mais il révèle surtout une mécanique : l’inquiétude naît du malentendu et du masque.
Car Marrakech n’est pas seulement une étape, c’est un théâtre de faux-semblants. Les Drayton, touristes affables, sont des complices d’assassinat. Louis Bernard, présenté comme homme d’affaires français, est un agent en filature — et, quelques minutes avant d’être poignardé, il traverse le marché grimé en « local ». L’identité se dédouble, parfois se ridiculise, et le hasard l’enraye : au tout début, lorsque Hank arrache par mégarde le voile d’une passagère, Bernard confond les McKenna avec les Drayton et scelle sans le savoir leur destin. Plus tard, un assassin pénètre dans la mauvaise chambre d’hôtel ; la méprise révèle, trop tard, que les rôles sont distribués. De fil en aiguille, Ben et Jo doivent à leur tour porter un masque — taire ce qu’ils savent à la police — tandis que Marrakech sert de chambre d’écho à leurs secrets : « c’est l’endroit le plus sûr », jure Ben, juste avant que Jo ne confie vouloir un autre enfant.
Cette ville dévoile aussi l’ombre chez l’« homme ordinaire ». Chez Hitchcock, les protagonistes les plus fertiles sont rarement monolithiques ; la duplicité intéresse plus que la pureté. À Marrakech, avant de devenir le père prêt à tout de la fin londonienne, Ben se montre « un peu terrible ». La scène la plus dérangeante du film le voit endormir de force sa femme dans une chambre d’hôtel, puis lui avouer qu’elle avait raison de se méfier de Bernard et des Drayton — et que leur fils a été enlevé. On pourra plaider le réflexe du mari-docteur des années 1950, « maître » des émotions jugées instables de sa femme, mais le geste demeure une manipulation crue qui rebat la distribution héroïque par rapport à 1934, où Jill tirait le coup décisif et partageait clairement le rôle de sauveuse.
Quant au « savoir de trop », il est, ironiquement, lacunaire. Bernard ne détient qu’un fragment — une cible, une ville — et légue à Ben un indice volontairement piégé : « Ambrose Chappell » noté comme un nom d’homme, qui mènera à un atelier de taxidermie et à une chapelle qui n’en est pas vraiment une. Le trajet vers Londres devient une poursuite par erreurs, là où l’original faisait de la capitale le cœur unique du danger. Dans la version de 1956, les lieux se répondent plus finement : l’Afrique du Nord est l’ancien « chez soi » de Ben, Londres celui de Jo, et leur opposition — le chirurgien mûr et la chanteuse vibrante — structure le mouvement du film. Lorsque l’axe familial saute avec l’enlèvement d’Hank, c’est la carte entière du récit qui se redessine.
Au détour de ces détours, le film montre ce que Marrakech révèle du mariage des McKenna : les intuitions de Jo, que Ben dément systématiquement ; les soupçons de médication « trop » facile appuyés par une époque où l’on pathologise les femmes ; la manière dont la confiance se fissure, puis se réajuste sous la pression. L’Homme qui en savait trop reste un thriller de lieux et de poursuites, mais son soubassement est un portrait conjugal traversé d’épines. Et si Hitchcock a préféré son remake, c’est peut-être parce qu’il y examine moins un crime qu’un accord dissonant — une cymbale unique qui ébranle, à Londres, ce que Marrakech a mis à nu. Source
Source : https://cinema.articlophile.com/blog/i/92858691/ma...






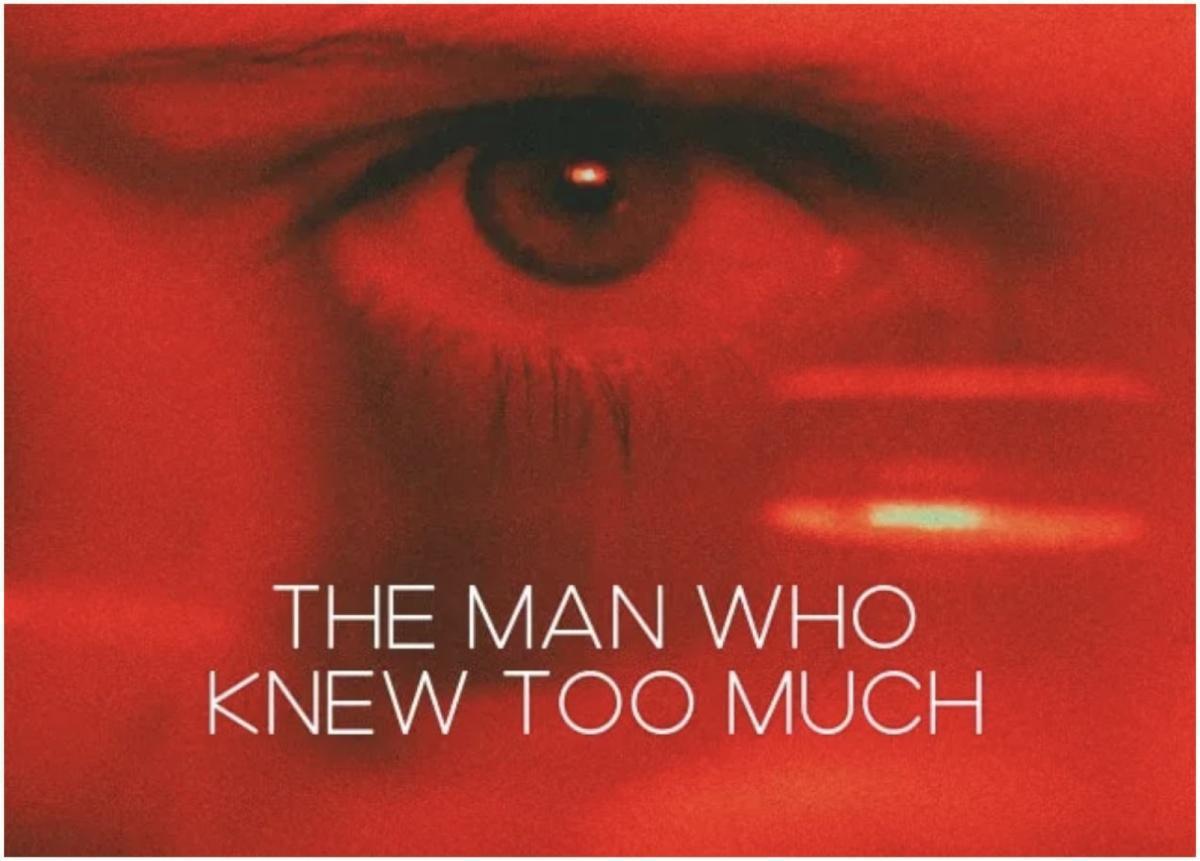
 Singapore Airshow 2026 : Air Cambodia commande à Boeing jusqu'à 20 737 MAX
Singapore Airshow 2026 : Air Cambodia commande à Boeing jusqu'à 20 737 MAX