Marrakech n’est pas un simple décor dans « L’Homme qui en savait trop » (1956) d’Alfred Hitchcock ; la ville oriente l’intrigue, expose les personnages et déploie une image de la cité vue par le cinéma occidental des années 1950. Le film annonce d’emblée son point d’orgue londonien — « A single crash of Cymbals and how it rocked the lives of an American family », clin d’œil au Royal Albert Hall — mais c’est à Marrakech que tout bascule, lorsque Louis Bernard s’effondre dans les bras du Dr Ben McKenna et murmure : « A man, a statesman, is to be killed… Tell them in London to try Ambrose Chappell. »
Pour un blog de veille sur Marrakech, l’intérêt de ce classique tient à trois axes. D’abord, la visibilité internationale de la ville. Le remake en couleurs, tourné sur place, inscrit Marrakech dans une cartographie du grand spectacle qui préfigure James Bond ou « Mission: Impossible » — Rogue Nation rejoue d’ailleurs le motif de l’attentat à l’opéra au Maroc. Ce capital symbolique, déjà puissant dans les années 1950, nourrit aujourd’hui encore les récits touristiques et médiatiques autour de la ville.
Ensuite, la question de la représentation. Le film encode Marrakech comme un espace d’ambivalence et de malentendus, « dark continent » dans la bouche des McKenna. Le choc culturel est parfois gag (manger du poulet avec les doigts), mais le scénario fonctionne surtout par quiproquos et masques : les Drayton, faux touristes ; Bernard, faux homme d’affaires ; un assassin qui entre dans la mauvaise chambre. Même la ville devient un leurre narratif : « Ambrose Chappell » pris pour un nom mène à une fausse piste. Pour la veille, ce matériau est précieux : il montre comment des œuvres-phares participent à des imaginaires persistants — entre exotisation et suspense — qui colorent encore les discours contemporains sur Marrakech.
Enfin, l’effet-miroir sur les personnages révèle un angle « lifestyle » localisable. À Marrakech, Hitchcock met à nu le couple McKenna : l’intuition de Jo sans cesse contredite, l’autorité médicale et conjugale de Ben qui va jusqu’à la sédation forcée, la confidence d’un désir d’enfant glissée « là où l’on ne peut pas être entendus ». La ville agit comme un révélateur — un hors-chez-soi qui autorise les vérités — avant que l’action ne se déplace à Londres. C’est une manière intéressante de penser Marrakech comme scène d’essai, où se jouent projection, risque et réagencement des liens.
Ce que ce film apporte au suivi de l’image de Marrakech :
-
Il fixe précocement une place de la ville dans la grammaire du thriller international, entre place publique, souk et hôtels.
-
Il documente un regard occidental daté, utile à contextualiser dans les analyses actuelles des récits touristiques et des tournages.
-
Il propose des motifs réutilisés par des franchises modernes, qui entretiennent la notoriété du cadre marocain.
En somme, « L’Homme qui en savait trop » met Marrakech au centre d’un mécanisme de faux-semblants et de transferts — « une cymbale unique » qui fait vibrer Londres après avoir fait parler la ville rouge. Pour un blog de veille, c’est un jalon à rappeler lorsqu’on cartographie les représentations de Marrakech : une ville-film qui, dès 1956, conjuguait aura internationale, clichés de l’époque et puissance de décor, tout en déclenchant une dynamique narrative devenue canonique. Source
Source : https://lemarrakech.articlophile.com/lebulletin/i/...






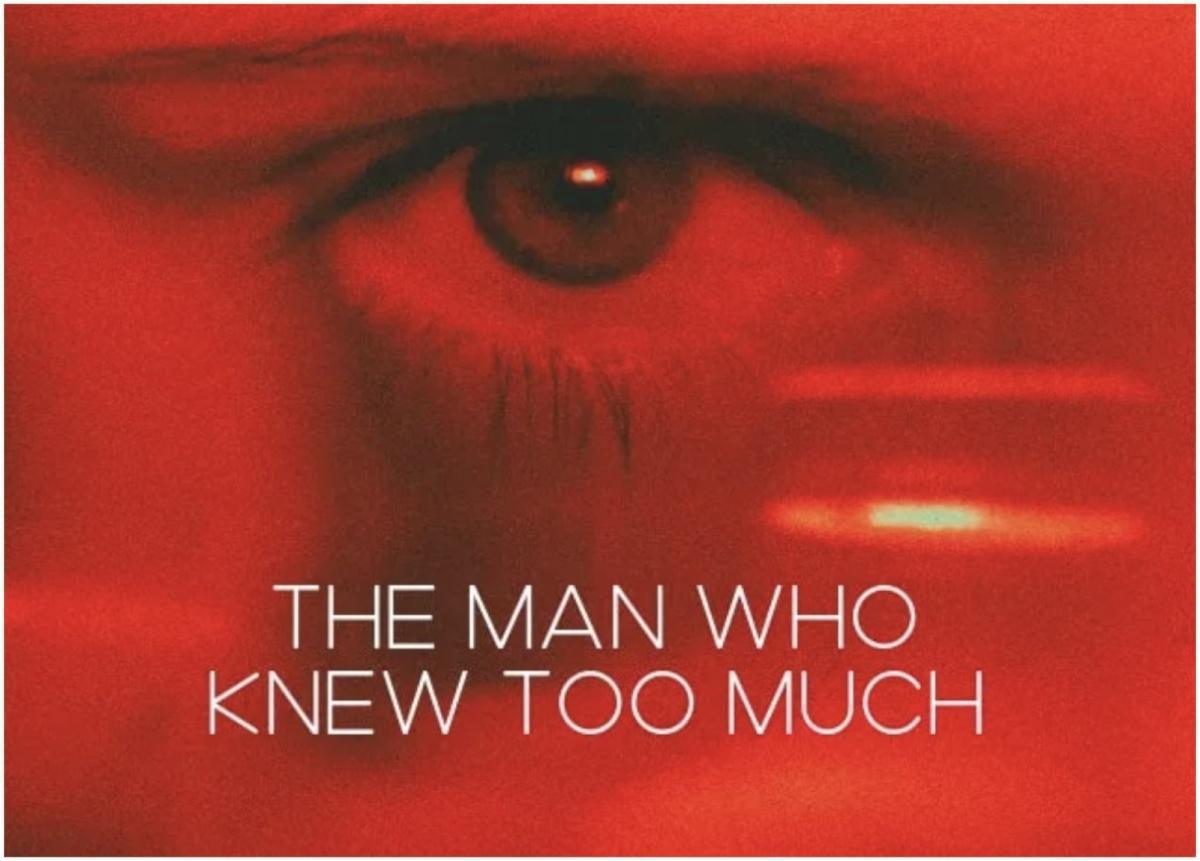
 Singapore Airshow 2026 : Air Cambodia commande à Boeing jusqu'à 20 737 MAX
Singapore Airshow 2026 : Air Cambodia commande à Boeing jusqu'à 20 737 MAX